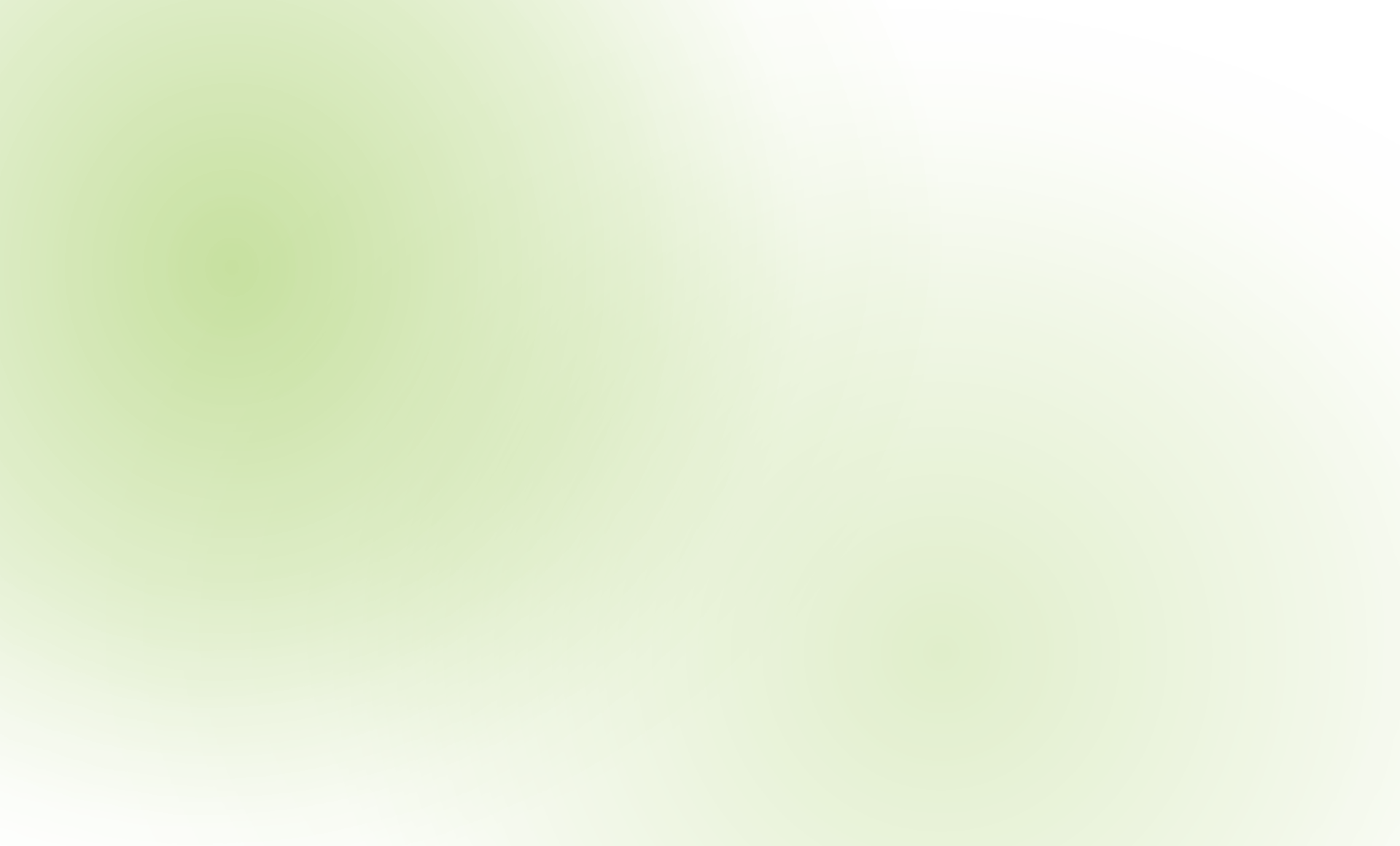Genopole
plateformes et infrastructures



Genopole
et les laboratoires de recherche






Anne Galy


Ioana Popescu


Vincent Bouhier
Quelles relations l’Université Évry Paris-Saclay a-t-elle nouées avec Genopole ?
Vincent Bouhier : L’université est membre fondateur de Genopole qui représente un acteur fédérateur et un catalyseur pour des actions communes dans des champs de recherche et de formation. Nous avons bâti des liens institutionnels indéfectibles notamment avec des sièges respectifs dans nos conseils d’administration. En matière de recherche, nous sommes membres fondateurs de GenoTher, le Gene Therapy Biocluster implanté à Évry-Courcouronnes. Depuis des années, nous développons à l’Université Évry Paris-Saclay, en lien avec Genopole, une offre de formations qui représente un enjeu majeur dans la recherche en génomique. De même, sur le territoire essonnien et en particulier Évryen, nous accompagnons la politique publique en matière d’essaimage à la fois de laboratoires de recherche et de jeunes entreprises.
Et s’agissant des laboratoires et des plateformes technologiques ?
V. B. : Genopole et l’université se sont nourris l’un de l’autre au cours des 20 dernières années au point qu’aujourd’hui neuf de nos laboratoires ont une activité directement liée à la génomique (thérapie génique, gestion de la data…) mais aussi à la biofonderie. Ces relations étroites ont permis de générer un écosystème avec le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) mais aussi l’Inserm et Genethon.
En matière d’innovation, nous avons notamment invité Christophe Lanneau, directeur du département Recherche & Plateformes de Genopole à se joindre à notre délégation pour la visite de nos partenaires du MIT à Boston (États-Unis) afin d’étudier nos pistes de collaborations communes et renforcer nos actions en faveur de l’innovation et de l’incubation. Nous sommes aussi impliqués dans les programmes ATIGEs, ApogeeBio ainsi que l’iGEM ou le hackathon D4Gen.
Nos équipes de recherche sont impliquées dans les plateformes de recherche, notamment la banque d’ADN et de cellules au Genethon, notre laboratoire LAMBE (Laboratoire Analyse, Modélisation Matériaux pour la Biologie et l’Environnement) pour l’imagerie et la spectrométrie de masse ou encore l’IBISC pour ses outils de bio-informatique.
Genopole et l’Université Évry Paris-Saclay se sont nourris l’un de l’autre au cours des 20 dernières années.
Quels événements communs organisez-vous ?
V. B. : La fête de la science nous tient particulièrement à cœur car elle permet d’attirer un public de jeunes femmes vers des formations de sciences expérimentales et exactes. Nous coorganisons des colloques, comme sur la Santé et l’IA, dans le cadre de l’association Évry Sénart sciences et innovation regroupant les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire Grand Paris Sud, ou encore le congrès thérapies innovantes et combinatoires avec Genopole. Il est important de faire le lien pour que les recherches et les brevets ne restent pas dans les laboratoires.

Anne Galy
L’ART-TG est implanté à Genopole depuis 2020. Quelle est sa mission ?
Anne Galy : L’ART-TG est un laboratoire de l’Inserm dédié à la thérapie génique. Sa mission est double : mener des projets de recherche sur le développement d’immunothérapies innovantes (cancer, maladies infectieuses, fibrose) ou sur le traitement de maladies génétiques (déficits immunitaires, drépanocytose), et accompagner le transfert de technologies pour amener de nouveaux produits de thérapie génique au stade de l’essai clinique. Cela suppose de combiner recherche fondamentale, savoir-faire pharmaceutique et maîtrise des procédés industriels notamment en matière de production de vecteurs viraux, comme les lentivirus, utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques.
Nous sommes un accélérateur de recherche technologique de l’Inserm : ce statut vise à structurer des expertises technologiques pointues pour soutenir la recherche biomédicale d’excellence et la mise au point de nouvelles thérapies. Cela comprend aussi une activité de partenariats académiques ou privés, en particulier sur la production et le contrôle qualité de vecteurs ou de cellules modifiées.
Quelles sont les grandes étapes récentes dans le développement de l’ART-TG ?
A. G. : L’ART-TG a été labellisé en tant qu’intégrateur en biothérapie et bioproduction dans le cadre du programme France 2030. Ce label reconnaît notre rôle dans l’effort national pour renforcer la souveraineté en matière de production de médicaments innovants.
Nous avons également obtenu fin 2024 la certification ISO 9001 sur nos activités autour des vecteurs lentiviraux. Cela renforce la crédibilité de notre offre notamment pour les essais cliniques. Enfin, nous hébergerons dès septembre 2025, en lien avec deux autres unités Inserm et l’Institut Imagine, la future plateforme Genomics and Genome Editing Quality Control du biocluster GenoTher dédiée à l’analyse de la sécurité des produits issus de l’édition du génome.
Quel lien l’ART-TG entretient-il avec Genopole aujourd’hui ?
A. G. : Genopole offre un cadre structurant pour notre activité. Il nous accueille dans ses locaux du bâtiment Cytopolis et met à disposition un environnement propice au développement de projets de pointe. Nous avons bénéficié de dispositifs de soutien comme une bourse ATIGEs pour une chercheuse – et plus largement, d’un écosystème stimulant, en interaction avec d’autres laboratoires et entreprises du site et faisant partie du campus d’excellence de l’Université Paris-Saclay.

Ioana Popescu
Qu’est-ce qui vous motive à participer à des concours, et en quoi ces expériences ont-elles influencé votre parcours ?
Ioana Popescu : Ces compétitions représentent pour moi une occasion unique de tester de nouvelles idées dans un cadre stimulant, entourée de personnes partageant la même passion. Elles me permettent de sortir de ma zone de confort, d’expérimenter des solutions innovantes et de travailler en équipe sur des projets concrets qui peuvent avoir un impact réel, bien qu’ils restent pour l’instant au niveau académique. Le concours iGEM m’a offert non seulement l’opportunité de développer des compétences techniques mais aussi d’explorer des aspects plus larges, tels que la communication scientifique ou l’éthique dans la biotechnologie.
Le Hackathon D4Gen organisé par Genopole nous a permis cette année de démarrer des travaux computationnels et d’utiliser l’intelligence artificielle dans le cadre du projet PHAGEVO. Nous y avons rencontré des étudiants très motivés dont la passion pour les sciences les a conduits à rejoindre l’équipe iGEM - Genopole Université Évry Paris Saclay 2024. Ces expériences ont renforcé ma conviction que l’innovation et la collaboration sont essentielles pour faire avancer la biologie de synthèse.
Quelles avancées majeures voyez-vous émerger en biotechnologie ? Et comment vos recherches s’y inscrivent‑elles ?
I. P. : Je pense que les prochaines avancées majeures en biotechnologie se situeront dans la bioproduction durable, l’édition génomique de précision et l’utilisation des technologies de l’IA pour optimiser les processus de R&D. Personnellement, je m’intéresse particulièrement à la bioproduction verte et à la mise en place de solutions plus durables, capables de réduire l’impact environnemental des industries pharmaceutique et chimique. Mes travaux actuels portent sur le développement de nouvelles souches de micro-organismes capables de produire des biomolécules d’intérêt de manière plus efficace et avec un bilan carbone plus faible.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes chercheurs qui souhaitent se lancer dans la bioproduction et les concours scientifiques ?
I. P. : Je leur dirais de ne pas hésiter à se lancer, même s’ils ont l’impression de ne pas avoir toutes les compétences ou connaissances nécessaires au départ. Les concours comme iGEM ou les hackathons sont des environnements propices à l’apprentissage, à l’échange d’idées et à la collaboration avec des experts du domaine. Il est important de rester curieux et de ne pas avoir peur de poser des questions ou de solliciter des mentors. Par ailleurs, je leur conseillerais de se constituer un réseau solide en participant à des événements et en interagissant avec des professionnels du secteur. Ces rencontres sont souvent des sources d’inspiration et peuvent déboucher sur des collaborations ou des opportunités de carrière.